XVIIe siècle
-

L'année 2004 a été notamment marquée par le trois centième anniversaire de la mort des deux plus grands prédicateurs français Jacques-Bénigne Bossuet (1627-1704) et Louis Bourdaloue (1632-1704). Poursuivant ses recherches sur la dynamique des genres, le GADGES publie les actes du colloque tenu à Lyon en octobre 2004 sur l'éloquence religieuse en France au XVIIe siècle. Bien des voies y ont été explorées : on a ainsi montré qu'avant Bossuet, des orateurs de talent avaient ouvert le chemin (Du Perron, saint François de Sales). A l'époque où parlait l'évêque de Meaux s'exprimaient aussi d'autres grands prédicateurs - Bourdaloue, Mascaron, en attendant Massillon, et surtout des prédicateurs protestants. Enfin, plusieurs communications ont été consacrées à l'étude de la théorie et de la stylistique du sermon au XVIIe siècle. Du Temps des beaux sermons se dégage une problématique féconde, en particulier sur les rapports entre la rhétorique et l'éloquence sacrée : la vérité chrétienne nécessite-t-elle le support profane des sortilèges de la rhétorique ? Dans ce monde imparfait, marqué par le péché et le mythe de la Tour de Babel, le prédicateur se voit contraint de situer son propos dans un espace incertain, à mi-chemin entre la transparence et la théâtralisation, entre l'absence et la présence, entre le vide et l'éclat. Assurément, le sermon est l'un des genres les plus fascinants, à la fois objet esthétique et moment liturgique. De cette tension naît un discours à la fois attendu - puisque le contenu est fixé par le dogme catholique ou la familiarité protestante avec la Parole de Dieu - et toujours surprenant, hésitant entre une formulation ornée et une expression véhémente.
-
-
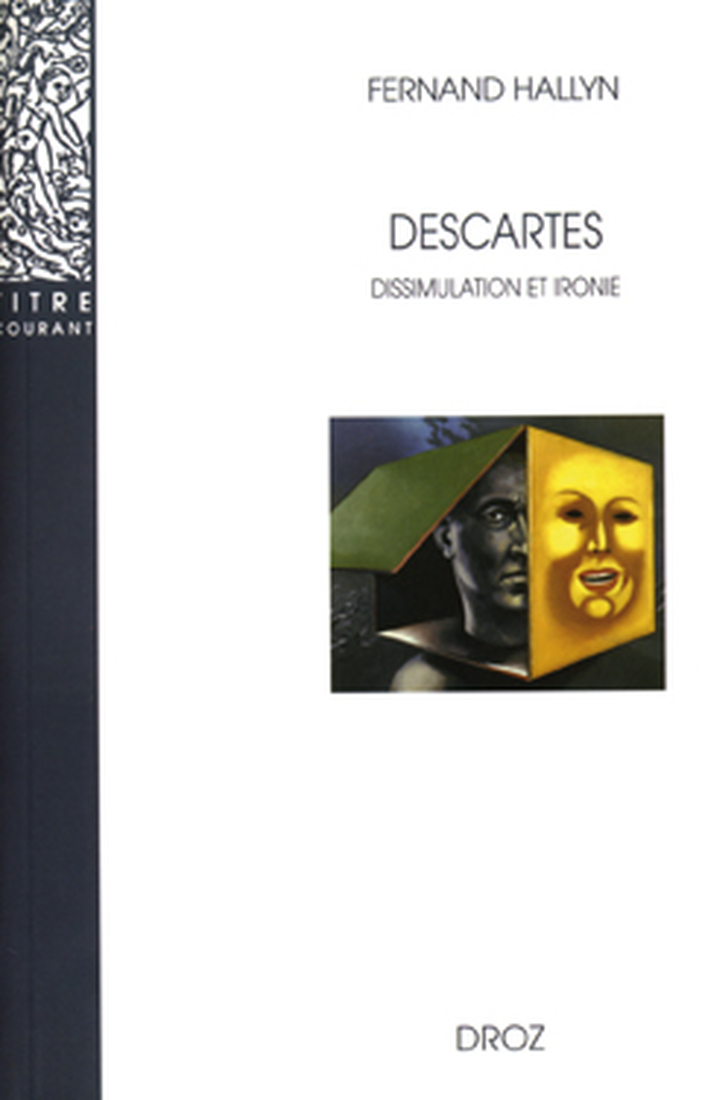
« Il y a peu de gens qui osent dire ce qu'ils croient », lit-on dans le Discours de la méthode. René Descartes fait sienne la constatation lorsqu'il évoque, toujours dans le Discours, certaines de ses réticences pour : « des personnes à qui je défère, et dont l'autorité ne peut guère moins sur mes actions que ma propre raison sur mes pensées. » Autrement dit : je suis le maître de ma pensée, ma raison est la seule autorité qui la gouverne ; mais l'« action », en l'occurrence le langage qui communique ma pensée, ne jouit pas de la même liberté.
A des idées évidentes, claires et distinctes ne correspond donc pas nécessairement un discours transparent. Inversement, un discours n'est jamais à ce point transparent qu'il ne puisse comporter, dans les plis et les replis du texte, une autre configuration de la « vérité », moins claire et évidente qu'il n'y paraît, non acceptée et non souhaitée, celle précisément qu'on désire réprimer. Tel est le point de départ de l'essai que Fernand Hallyn consacre à ce que Descartes dissimule aux autres - et parfois à lui-même.
-

Donner la parole aux images, les animer : tel semble bien être l'enjeu majeur de la «rhétorique des peintures» qui trouve à s'exprimer dans la littérature spirituelle jésuite du XVIIe siècle. Le corps de l'image réclame une âme, comme ne cessent de le répéter les préfaces aux livres illustrés depuis le XVIe siècle, constatant ainsi la nécessité d'un composé scripto-visuel au cœur de toute économie symbolique. Ralph Dekoninck s'attache, dans un premier temps, à définir cette dernière au sein de ce qu'il est convenu d'appeler la culture visuelle jésuite, largement tributaire de l'anthropologie chrétienne médiévale et de ses remaniements modernes. Le principe de la ressemblance en acte et de l'imitation existentielle que supposent la «théologie du visible» et la «philosophie de l'image» des membres de la Société de Jésus a nourri une riche iconologie, fondée sur l'incarnation du Verbe, c'est-à-dire sur le principe d'un Logos fait image, induisant à son tour l'idéal du «tableau vivant» ou de la «peinture parlante». Sur la base d'une analyse des livres de spiritualité illustrés à Anvers entre 1585 et 1640, la seconde partie de l'ouvrage examine comment la production visuelle jésuite rejoue la dynamique christologique de l'avènement de la vérité à la visibilité et la dialectique anthropologique de la poursuite de la ressemblance dans la dissemblance, ce double mouvement qui présume que le sens n'est jamais donné d'emblée, mais reste toujours à conquérir.
-

On sait ce qu'il en est de la transparence du discours, et la parole semble souvent masquer plutôt que produire ou révéler son objet. Ce volume tente d'explorer principalement l'inscription de ces pratiques retorses dans les genres littéraires aux XVIe et XVIIe siècles. Certes, les textes à clé et les déguisements d'auteur posent de manière éclatante la question de la mystification littéraire. Mais même dans les écritures revendiquant la vérité - essai, histoire, satire -, le travail de la citation, les jeux énonciatifs brouillent le genre d'origine et utilisent le détour pour accéder au vrai. Dans les genres de la fiction, le théâtre décline tous les artifices d'une représentation et d'une énonciation complexes : corps à interpréter, comédien transformé par son rôle, scènes à visées multiples, discours protéiformes - secrets, surpris, équivoques, artificieux - où s'estompent les différences entre tragédie et comédie, où émerge l'anthropologie sous-jacente. Mais c'est sans doute l'écriture romanesque qui mène le plus loin ces jeux du mensonge et de la vérité. Le titre, la traduction, les registres et les tons, les voix inscrites dans le roman, les jeux avec l'institution littéraire construisent non seulement l'énigme de l'histoire et des personnages, mais celle de l'auteur, de ses visées et plus généralement de la signification de l'œuvre, selon un « esprit de complexité » qui définit la modernité du roman. Par l'exhibition des artifices de la littérature, c'est au déchiffrement que nous sommes invités : dans l'œuvre spirituelle où les figures sont accès à la transcendance, mais aussi dans l'œuvre de fiction où le lecteur diligent doit élucider les signes. Le plaisir du texte et la recherche du sens sont ici inséparables : la parole masquée, au cœur de toute œuvre littéraire, s'avère, paradoxalement, un puissant révélateur.
-

Sommaire: P. Bourgain, «Réflexions médiévales sur les langues de savoir»; A. Grondeux, «Le latin et les autres langues au Moyen Age: contacts avec des locuteurs étrangers, bilinguisme, interprétation et traduction (800-1200)»; P. Lardet, «Langues de savoir et savoirs de la langue: la refondation du latin dans le De causis linguae latinae de Jules-César Scaliger (1540)»; J.-M. Mandosio, «Encyclopédies en latin et encyclopédies en langue vulgaire (XIIIe-XVIIIe siècles)»; C. Lecointre, «L’appropriation du latin, langue du savoir et savoir sur la langue»; M. Furno, «De l’érudit au pédagogue: prosopographie des auteurs de dictionnaires latins, XVIe-XVIIIe siècles»; B. Colombat, «Changement d’objectif et/ou changement de méthode dans l’apprentissage du latin au XVIIe siècle? La Nouvelle Méthode […] latine de Port-Royal»; M. Bouquet, «Le De viris illustribus de Lhomond: un monument de frantin»; J. Royé, «La littérature comique et la critique du latin au XVIIe siècle»; M. Lemoine, «Les néologismes dans le commentaire de Calcidius sur le Timée»; J. Ducos, «Passions de l’air, impressions ou météores: l’élaboration médiévale d’un lexique scientifique de la météorologie»; J. Paviot, «Le latin comme langue technique: l’exemple des termes concernant le navire»; M.-J. Louison-Lassablière, «Antonius Arena ou le latin macaronique au service du savoir chorégraphique»; L. Boulègue, «Le latin, langue de la philosophie dans les traités d’amour du XVIe siècle en Italie. Les enjeux du De Pulchro et Amore d’Agostino Nifo»; G. Demerson, «Langue ancienne et nouveau Monde»;
A. Vanautgaerden, «L’œuvre ‘latin’ de Jean Froben, imprimeur d’Erasme»; J.-F. Cottier, «Les Paraphrases sur les Evangiles d’Erasme: le latin, instrument de vulgarisation des écritures?»; D. de Courcelles, «Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), traducteur du grec et historiographe en langue latine: sur le choix de l’écriture en langue latine en Espagne vers 1540»; H. Cazes, «La Dissection des parties du corps humain et son double: les anatomies latine et française de Charles Estienne (Paris, 1545-1546)»; E. Wolff, «Jérôme Cardan (1501-1576) et le latin»; L. Goupillaud, «Demonstrationem mirabilem sane detexi: mathématiques et merveille dans l’œuvre de Pierre de Fermat»; J. Schmutz, «Le latin est-il philosophiquement malade? Le projet de réforme du Leptotatos de Juan Caramuel Lobkowitz (1681)»; Y. Haskell, «Bad taste in baroque Latin? Father Strozzi’s Poem on Chocolate»; A. Michel, «Le latin, les mots et les choses: Virgile, Eckhart, Edmond Jabès».
-
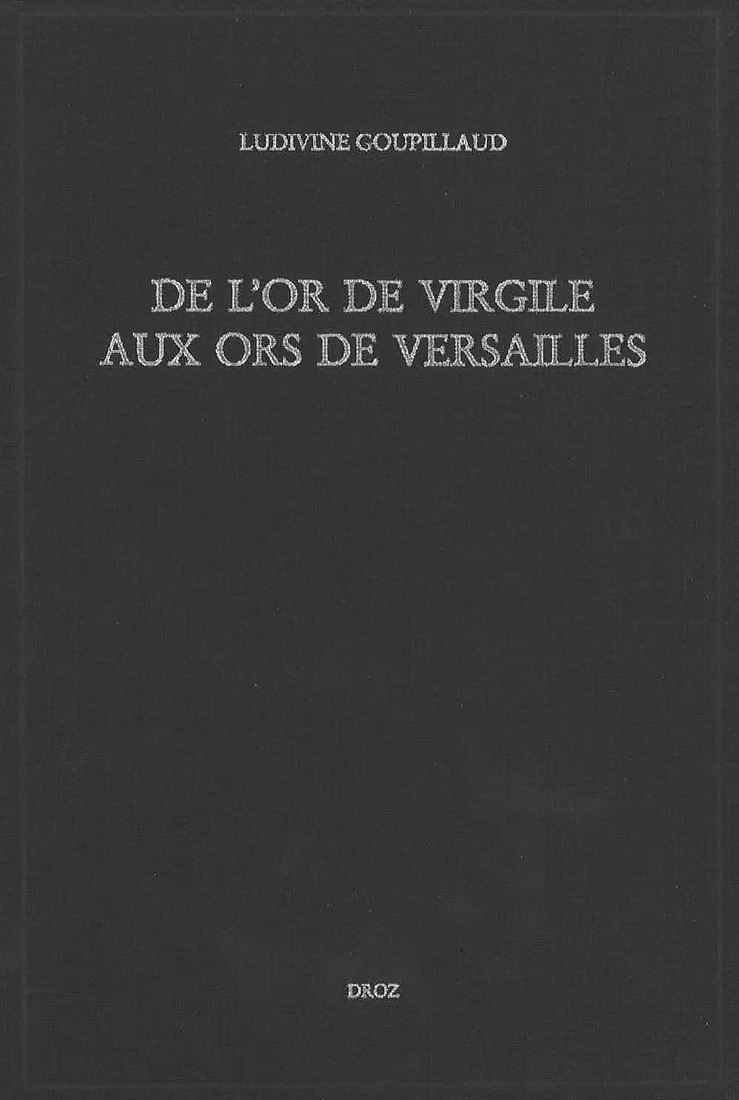
Partant du principe qu'il n'existe pas d'écriture orpheline au XVIIe siècle, Ludivine Goupillaud apprécie la filiation unissant les hommes du siècle de Louis XIV à l'auteur de l'Enéide. Ainsi examine-t-elle successivement le cas des « héritiers » - qui revendiquent ouvertement le patrimoine virgilien -, celui des « fils prodigues » - qui s'en réclament, tout en cherchant de nouveaux modèles appropriés à leur temps -, celui, enfin, des « affranchis » - qui contestent ouvertement la suprématie poétique du Cygne de Mantoue et briguent une totale autonomie par rapport aux auctoritates antiques. La richesse des opinions résiste à une explication sommaire que l'on poursuivrait vainement dans la dichotomie habituelle entre « Anciens » et « Modernes ». Il s'agit plutôt de montrer, analyses textuelles à l'appui, que l'Enéide est la source vive à laquelle puisèrent, avec des présupposés et des ambitions différents, voire divergents, tous les hommes qui, au XVIIe siècle, faisaient profession d'écrire ou, plus largement, de créer. En effet, le rôle formateur de l'épopée virgilienne se manifeste également dans d'autres domaines artistiques, comme la peinture ou l'architecture. De là cette analogie, si souvent rencontrée dans les textes contemporains, entre l'épopée et un grand palais ; c'est Versailles en effet qui parvient à matérialiser, mieux que ne l'eût fait le récit des exploits de Louis le Grand, l'apogée « héroïque » d'une culture et d'une sensibilité originales.
-

L'étonnement ne tarit pas à la découverte de la Novissima Linguarum Methodus que l'intellectuel morave Jan Amos Komensky, mieux connu sous le nom de Coménius, publie en 1648 dans laquelle il expose et justifie sa méthode d'enseignement et d'apprentissage des langues. Ce traité possède à peu près toutes les caractéristiques d'un manuel du XXe siècle et fait incontestablement de son auteur l'initiateur de la pédagogie moderne. Sa conception du langage, des langues véhiculaires et vernaculaires, sa définition des relations entre la langue et la réalité individuelle, sociale et culturelle de ceux qui la pratiquent, de même que ses conceptions pédagogiques, autrement dit l'accointance qu'il établit entre une instruction universelle et la perfectibilité humaine, sont en avance de trois siècles sur les opinions ethnolinguistiques et didactiques de l'époque. A la lecture de La toute nouvelle méthode des langues, traduite en français pour la première fois, il est permis de se demander si l'approche de Coménius ne serait pas le chaînon manquant entre les grandes interrogations de Platon et de Saint Augustin sur des sujets du même ordre et celles de savants contemporains comme De Saussure, Bloomfield, Martinet et Piaget.
A l'heure où la communauté francophone s'interroge de par le monde sur ce qu'il est convenu d'appeler l'exception culturelle, la réflexion de Coménius contient de précieuses analyses et abonde en pistes comme en solutions.
-
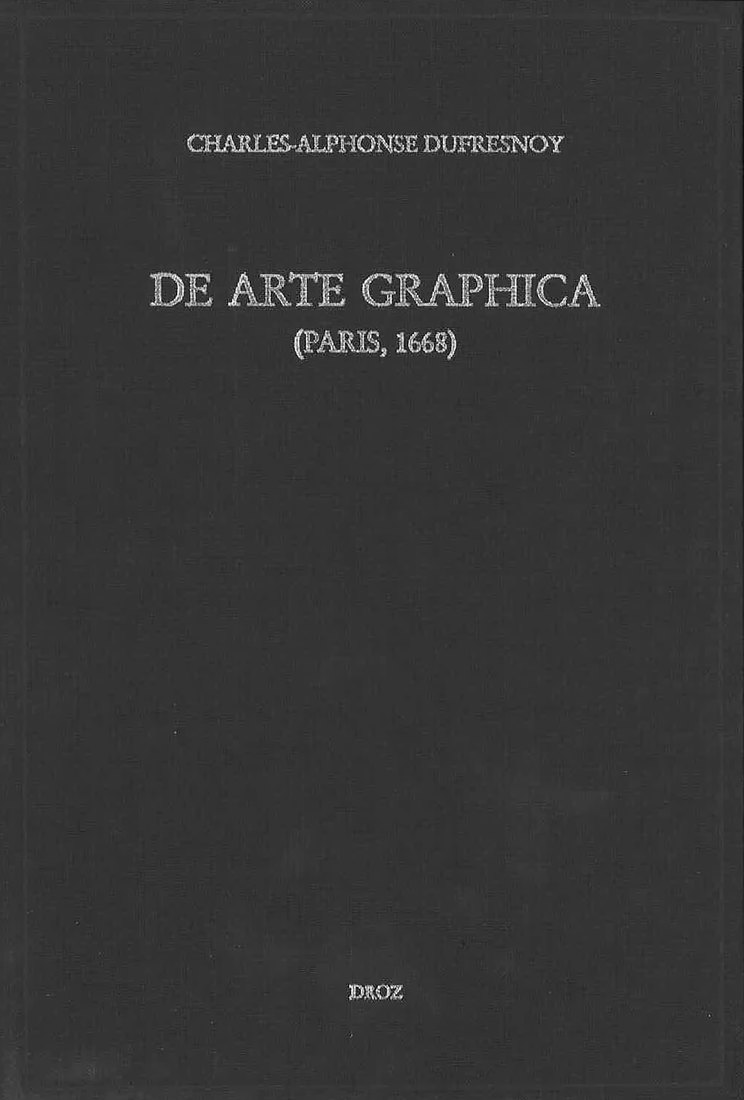
De arte graphica, poème didactique en latin sur l’art de la peinture, fut commencé par Charles-Alphonse Dufresnoy à Rome vers le milieu des années 1630 et vit enfin le jour à Paris en 1668, quelques mois après la mort de l’auteur. Cette première édition, accompagnée d’une traduction et d’un commentaire par Roger de Piles, connut un succès considérable. Elle devint bientôt un classique moderne et une référence indispensable pour les académies d’art fondées partout en Europe au XVIIIe siècle, ce qui ne va pas sans une certaine ironie quand on pense aux relations difficiles entre Dufresnoy et surtout Roger de Piles et l’Académie Royale de Peinture et de Sculpture, modèle de toutes les autres. Le poème de Dufresnoy connut ainsi de multiples éditions et traductions au cours du siècle et demi qui suivit sa première parution, avant de tomber dans l’obscurité avec le triomphe du romantisme et de l’art moderne.
Pour le lecteur contemporain, De arte graphica représente surtout une distillation des deux premiers siècles de la théorie moderne de la peinture – d’Alberti et Léonard de Vinci à Dolce, Lomazzo, Vasari, Armenini et, enfin, à Agucchi et à l’ami de Dufresnoy Giovanni Pietro Bellori. Les 549 vers de son poème latin, avec les essais préliminaires et le commentaire détaillé qui constituent la présente édition, forment ainsi une véritable introduction aux principaux thèmes de la théorie moderne de la peinture.
-
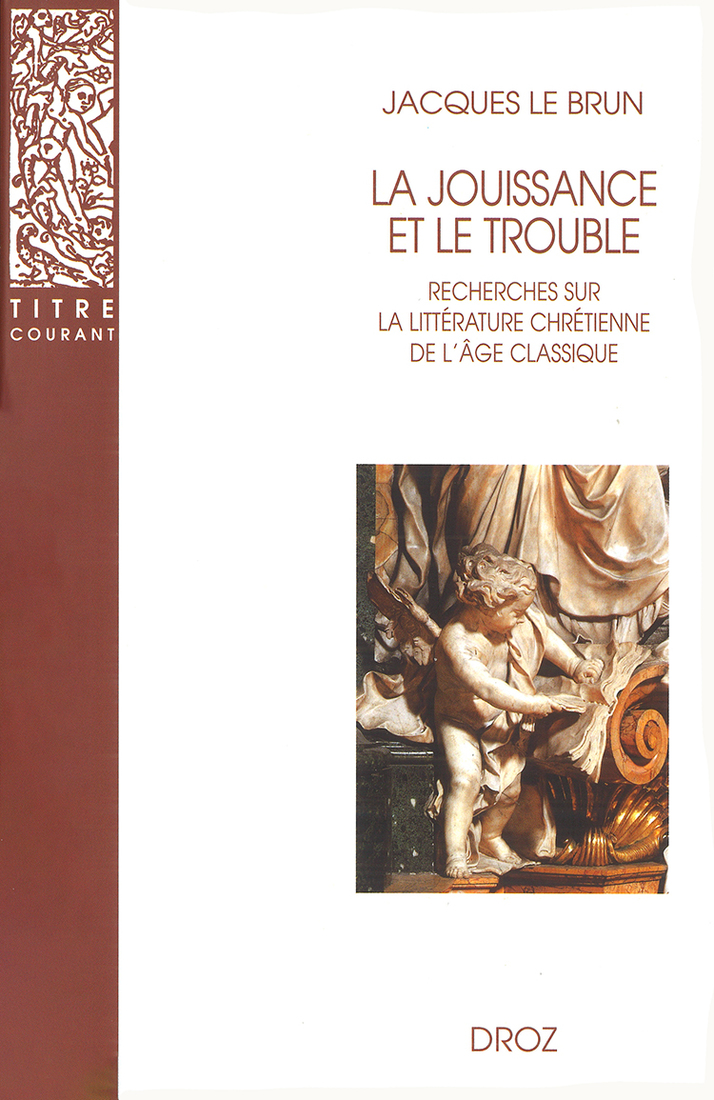
A l’époque moderne, l’éclatement de la chrétienté en confessions rivales, en un “catholicisme” et des “protestantismes”, a suscité le développement de la controverse et l’élaboration d’une immense littérature religieuse. L’écrit, et particulièrement l’imprimé, devenait l’instrument du débat théologique et philosophique. Ce faisant, l’interprétation des écrits – la Bible, les Pères, les auteurs spirituels –, l’établissement du sens des textes et l’émergence de l’ " auteur " au sens moderne du terme entraînaient à leur tour un problème philosophique autant que théologique et donnaient naissance à des disciplines autonomes, l’exégèse et l’herméneutique. Les travaux rassemblés dans ce livre constituent un essai d’interprétation de plusieurs corpus textuels, d’œuvres de philosophes, de théologiens et d’auteurs spirituels. Ils fournissent une réflexion sur la constitution ou la modification des références fondatrices (le rapport à une origine, les structures psychiques ou anthropologiques). Que les questions de la spiritualité, de la dévotion et de l’institution soient centrales dans ces recherches n’étonnera pas : l’homme moderne y est engagé, s’affirmant comme sujet de son expérience.